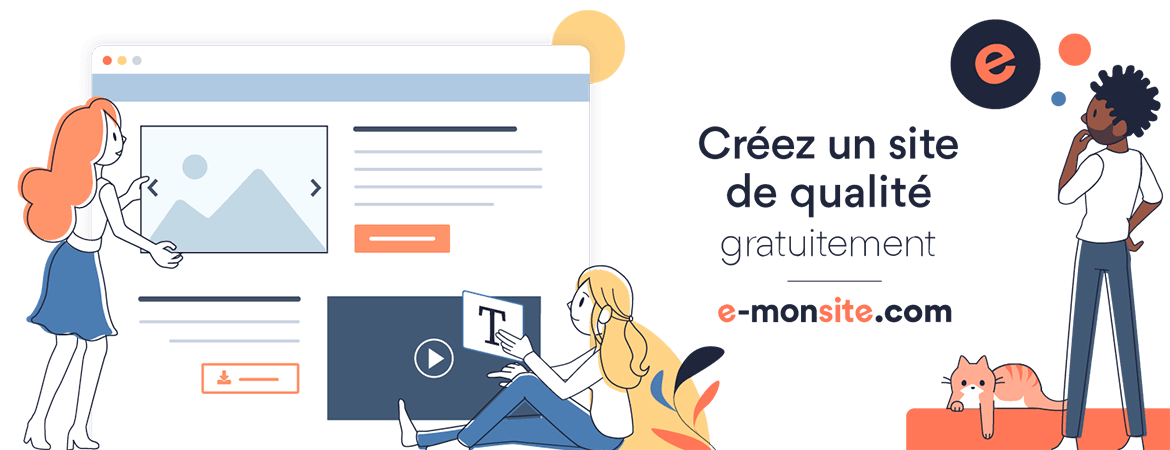ATELIER MAI 2015
HISTOIRE DE LA HAIE EN PAYS D'AUGE par Christiane DORLEANS
 On ne présente plus Christiane Dorléans qui vient quasiment tous les ans faire une présentation. :
On ne présente plus Christiane Dorléans qui vient quasiment tous les ans faire une présentation. :
Mai 2005 : le jardin conservatoire, Juillet 2006 : les plantes remèdes du pays d’auge, Décembre 2007 : l’hiver en pays d’auge, Juillet 2009 : visite du jardin conservatoire, Septembre 2011 : usage des plantes au Moyen-Age pour les 1100 ans de la Normandie, Mars 2012 : usage des plantes vétérinaires, Septembre 2013 : Les plantes poisons.
Native de Monviette, elle s’occupe de l’association Montviette Nature, du Jardin conservatoire de St Pierre sur Dives et a pour but de recueillir auprès des anciens les histoires et espèces du jardin en pays d’Auge. A ce titre de nombreux ouvrages sont édités par Montviette Nature et je vous encourage d’aller voir ce petit coin perdu de campagne (on a participé à une sortie cueillette et cuisine organisée par l’association) et son site internet www.patauge.org.
Comme d’habitude, Christiane est venue avec un panier de feuillage pour illustrer son diaporama.
A la fin de l’atelier, nous avons fêté les 25 ans de Monviette, les 20 ans du jardin conservatoire autour d’un pot de l’amitié et Christiane nous a offert un de ses livres (Jardin savoureux tome 2).

Dans l’histoire du paysage, on a pu constater que la confrontation des outils de datation de Hooper (qui considère sur 30m de haie le nombre d’espèces pour en déduire l’âge de la haie) ne fonctionne pas (sur la base des noms, de la géologie…). Christophe Manœuvrier a repris l’étude.
Le mot bocage vient de bosc (bois). Le seigneur octroyait des droits d’utilisation : on pouvait prendre le bois de diamètre inférieur au poing). Cela correspond à la période de défrichement des bois par les seigneurs au Moyen-âge. La haie (haye au moyen-âge) correspond à un bois en longueur, assez large, épineux, séparant deux seigneuries.
Au Xème siècle, toutes les paroisses sont installées au Pays d’Auge. Les landes (plutôt de bruyères) sont défrichées au profit de la culture (blé, avoine pour cervoise car on ne boit pas d’eau seule à cette époque, mais pas d’orge).
 Pour défendre les cultures des animaux en pâture, on installe des haies de houx (XIIIème siècle) : cette plante appétente présente des feuilles piquantes en bas pour survivre et des feuilles hautes rondes car elles n’ont pas besoin de défense vis-à-vis des bêtes. On creuse un fossé autour de la parcelle et on dresse un talus.
Pour défendre les cultures des animaux en pâture, on installe des haies de houx (XIIIème siècle) : cette plante appétente présente des feuilles piquantes en bas pour survivre et des feuilles hautes rondes car elles n’ont pas besoin de défense vis-à-vis des bêtes. On creuse un fossé autour de la parcelle et on dresse un talus.
Au XIVème siècle, ce n’est plus du houx mais de l’aubépine qui sert aux parcelles des fils du seigneurs.
On dit que « quand aubépine entre en fleurs, temps en rigueur », parallèle à faire avec l’été de la St Martin en Novembre. Le prunellier lui protège les animaux des mares (son dard est toxique).
On plante le ‘petit érable) en haie basse (érable champêtre, parfumé et jaune à l’automne).
À partir du XVIème siècle, on utilise l’orme (la feuille se distingue de la charmille par un petit décochement). Actuellement, la graphiose décime l’orme : l’insecte pique en mai-juin et le champignon tue en juillet. Lorsqu’un orme est épargné, ses graines sont envoyées au CREPAN (cf. atelier février 2015)qui se charge de les diffuser pour la survie de l’espèce.
L’aubépine était aussi vecteur du feu bactérien mais son interdiction de vente a été levée il y a 2-3 ans.
Au XIXème siècle, il n’y a plus de talus (plus besoin de drainer) et plus d’animaux. On s’oriente vers des arbres de rapport comme le charme (qui vient de l’est) en têtard : l’arbre est au propriétaire et les branches au locataire.
Au départ, il n’y a qu’une espèce dans la haie mais le temps et les oiseaux provoquent des mélanges.
Au XIXème siècle, il y a une seule haie en lisière où on retrouve plusieurs espèces : bouleau, merisier, chêne (pédonculé dont la feuille est sur le rameau, sessile où tout contre (gland) de feuille détachée), hêtre, tilleul sauvage (cordata, fleurit plus tard, d’où St Etienne La Thyllaie), érable sycomore ou plane, poirier sauvage (un manuscrit du XIVème siècle, on trouve trace de la vente d’une parcelle pour fabrication de vaisselle), if, noisetier. Il n’y a pas de châtaigner (qui a besoin d’un terrain acide, non argileux). D’ailleurs, les plafond en châtaigner sont en fait du chêne sessile (dont le bois est différent du chaine pédonculé).
On compte près de 60 espèces ligneuses.
L’épine vinette a été éradiquée car vecteur de la maladie du charbon dans les blés (berbéris).
Le genévrier (juniperus) a disparu car il était arraché pour nettoyer les tonneau, adjoint à de la saumure, pot à lard : il n’est plus dans la haie mais planter dans la ferme.
Au 01/01/2016, la haie sera protégée par la PAC : l’arrachage sera interdit.
Le buis se naturalise difficilement (Ouilly le vicomte). On le trouve autour des jardins potagers en défense magique.

La haie morte consiste à planter des piquets de bois entre lesquels on empile du bois mort en tassant (perche transversale puis serre-haie pour avoir une même largeur) et on ligature avec du noisetier torsadé ou de la ronce. Il n’y a pas de haie plessée en Pays d’Auge.
On trouve aussi du fusain, de la clématite, du chèvrefeuille, du fragon (qui servait à housser les voûtes des églises), le thuyas servait à faire des objets parfumés..
Le frêne est lui aussi victime d’une maladie semblable à la graphiose pour l’orme.